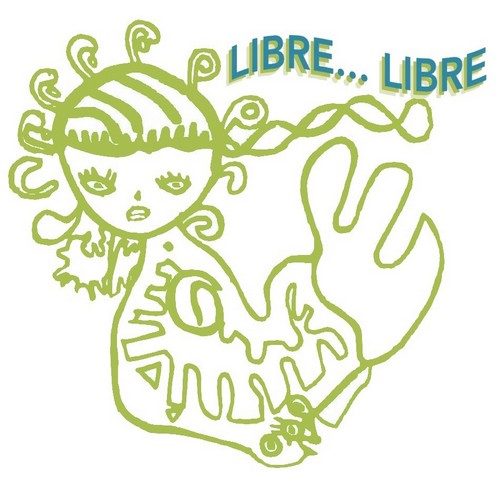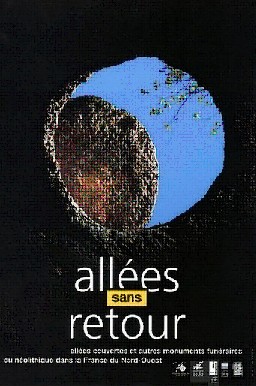Étude du milieu, quelques pistes… ouvertes bien sûr
Quelques cas de figures :
1) Sortie promenade, autour de l’école ou dans la cour ou en forêt ou…
La sortie n’est pas préparée, seule consigne : rester en groupe.
Je suis aux aguets : dès la première observation ou question posée ou remarque ou affirmation d’un enfant, j’arrête le groupe et l’invite à la réflexion : observation, analyse, discussion, émergence des représentations de chacun. J’anime le groupe en forçant les enfants à s’exprimer : « Pourquoi dis-tu cela ? À ton avis pourquoi c’est comme ça ? Qu’en penses-tu ? Etc. »
Et déjà, sur le lieu de la sortie, chacun a pu exprimer ses représentations, sa connaissance qui sont transformées par le groupe. Déjà des pistes s’ouvrent avec des éléments de réponses mais aussi des questionnements.
Le groupe entier (si gros groupe) n’est pas forcément intéressé par le sujet étudié mais les enfants patientent et attendent une autre observation sur laquelle ils percuteront. Je les « force » à rester près de nous, calmement. Ils n’ont peut-être pas été intéressés mais ils ont peut-être entendu.
Plusieurs arrêts lors d’une sortie.
De retour en classe : débat collectif. Chacun s’exprime et nous retenons quelques pistes.
Ensuite les thèmes les plus porteurs (ceux qui font parler le plus d’enfants) sont de nouveau discutés en collectif chacun leur tour et un bilan est fait : ce que nous avons appris et les questions que nous nous posons.L’étape suivante est ou peut être la recherche documentaire organisée, à partir de questions bien précises. Je dis bien « peut être » car le gros du bénéfice de la sortie s’est fait lors de la sortie, sur le lieu, car c’est là que les enfants ont fait travailler leur pensée. Quand on se pose une question, on entre dans la culture.
La recherche documentaire prenait des formes différentes selon l’âge des enfants : examen collectif de documents apportés par moi, partage des questions, recherche de la documentation à la bibliothèque (BCD) par petits groupes, rédaction des réponses collectivement ou par groupes…
2) La sortie est préparée : visite d’un musée, d’un lieu culturel…
Là encore, premier travail, expression des représentations mentales à partir de questions : « Que pensez-vous aller voir ? Qu’aimeriez-vous voir ? Qu’allez-vous rencontrer ? »
Je pouvais aussi organiser ce questionnement autour d’une affiche, celle de l’exposition par exemple qui était le but de la visite.
Ensuite, même chose que pour le cas 1.
De retour en classe, débat sur ce dont les enfants se souviennent, ce qui les a marqués, sans chercher à imposer une connaissance quelconque en dehors de la préoccupation des enfants.
3) Profiter d'un questionnement
L’étude du milieu peut arriver occasionnellement en classe, lors de l’entretien du matin par exemple : « Eh bien moi j’ai appris quelque chose, on a tous un escargot dans l’oreille… »
Alors, débat, questionnements, expression des représentations, chacun y va de sa connaissance…
Pour la suite, comme au cas 1.
4) Un débat seul
Parfois le débat seul suffit à apporter les réponses à une question.
Exemple : Une question a été posée au cours de la journée « Au fait, de quoi sont faits les nuages ? »
Il n’était pas possible de traiter la question de suite. Alors j’ai programmé le débat pour un autre jour.
Et le débat a suffi pour faire émerger les réponses, chaque enfant apportant son savoir, ses observations.
Les enfants ont parlé de la vapeur, de la glace, de la buée sur les carreaux qui se forme quand l’eau bout pour cuire les pâtes… et à la fin du débat, ils ont trouvé les trois états de l’eau. Ne restait plus qu’à rédiger ensuite une fiche bilan pour le cahier de vie ou de lecture, avec dessins à l’appui.
Quelques jours après des enfants sont revenus de la bibliothèque avec des livres de sciences dans lesquels ils avaient trouvé des documents qui vérifiaient nos réponses.
Monique Quertier, 24 novembre 2014
Exemple :
Dossier compte rendu de tout le travail réalisé par des enfants de CE1/CE2 autour d'une visite au château d'Écouen, Musée de la Renaissance
→ voir le dossier